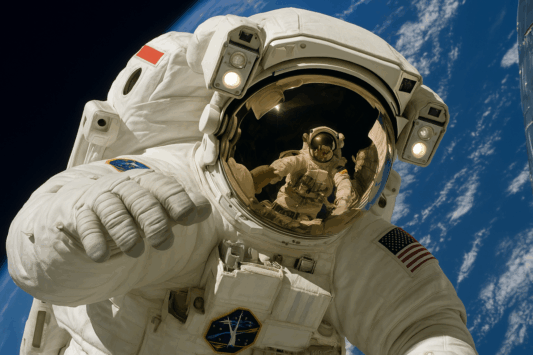12 décembre 2021, Abu Dhabi : à l’issue d’un Grand Prix très disputé, comme la Formule 1 n’en avait pas connu depuis longtemps, Max Verstappen est sacré champion du monde des pilotes, au détriment de Lewis Hamilton – tenant du titre, et septuple champion.
22 décembre 2021, Alicante : à l’issue d’une procédure d’opposition initiée un peu plus de six ans plus tôt, c’est hors des circuits que Lewis Hamilton essuie une nouvelle défaite, dans une course qui l’opposait à la marque antérieure HAMILTON – entreprise d’horlogerie fondée au 19ème siècle et aujourd’hui partie du groupe Swatch1.
Lewis Hamilton, célèbre pilote britannique de Formule 1, est d’ores-et-déjà titulaire de plusieurs marques européennes sur son nom2. Il s’est néanmoins vu refuser par l’EUIPO l’enregistrement de la marque LEWIS HAMILTON en classe 14 (montres et bijoux, essentiellement) et en classe 35 pour les services de vente relatifs aux produits de cette même classe, sur opposition du titulaire de la marque antérieure HAMILTON.

Cette procédure débute le 1er décembre 2015, avec la notice d’opposition partielle déposée par la société Hamilton International AG à l’encontre de l’entière classe 14 du dépôt n° 014365837 et une partie de la classe 35, pour ce qui y est lié. (La demande de marque désigne initialement un plus grand nombre de classes et fera l’objet d’une demande de division en 2018.)
Outre une action en nullité que Lewis Hamilton va initier en parallèle à l’encontre de la marque antérieure HAMILTON (aux fins de possiblement voir l’enregistrement qui lui est opposé annulé) et qui sera rejetée par l’EUIPO3, la défense du pilote s’articule principalement autour des différences existant entre les signes – de par l’ajout de son prénom, LEWIS, mais aussi et surtout de par sa notoriété en tant que pilote de Formule 1, qui permettrait au signe déposé d’être conceptuellement différent de la marque HAMILTON.
Court rappel : dans le cadre d’une opposition, pour apprécier l’existence d’un risque de confusion entre deux signes, vont être tour à tour analysées les éventuelles similitudes ou différences visuelle, orale / phonétique et conceptuelle. Concrètement, l’examinateur va se poser les questions suivantes :
- Est-ce que les signes, placés côte-à-côte, se ressemblent visuellement ou non ? (notamment, par exemple, comportent-ils un même nombre de mots/lettres, ou des logos qui sont proches, à l’œil du public pertinent ?)
- Est-ce que les signes comparés peuvent être prononcés d’une façon similaire ou différente ?
- Est-ce que les signes comparés vont évoquer la même idée à l’esprit du consommateur ?
Si d’autres facteurs entrent bien entendu en ligne de compte pour conclure in fine à l’existence ou à l’absence d’un risque de confusion, ces trois critères constituent la base immuable d’une comparaison entre deux signes dans le cadre d’une procédure d’opposition, et par un jeu de balance : ils peuvent parfois se neutraliser.
C’est ainsi que selon une jurisprudence constante, une dissimilarité conceptuelle est de nature à surplomber les éventuelles similarités visuelles et phonétiques des signes comparés – ce que l’on nomme parfois « théorie de la neutralisation »4.
A titre d’illustration, l’une des premières instances où cette théorie a été appliquée est assez parlante : le titulaire de la marque antérieure PICASSO n’avait pas été en mesure de bloquer l’enregistrement de la marque PICARO, puisque « sur le plan conceptuel, le signe verbal PICASSO est particulièrement bien connu, par le public pertinent, comme étant le nom du peintre célèbre Pablo Picasso.
Le signe verbal PICARO peut être compris, par des personnes hispanophones, comme désignant, notamment, un personnage de la littérature espagnole »5. Et cette forte différence conceptuelle venait neutraliser les ressemblances visuelles et orales existant entre les deux signes.
Une dissimilitude conceptuelle peut ainsi être constatée si chacune des marques comparées renvoie à un concept ou une idée clair(e), de nature à être directement perçu(e) / compris(e) par le public, qui diffère de celui/celle de l’autre signe. Si tel est le cas, cette dissimilitude peut alors à elle seule neutraliser les ressemblances visuelles et phonétiques existantes et écarter le risque de confusion.
C’est donc cette théorie que le pilote Lewis Hamilton a tenté de faire valoir dans la procédure d’opposition qui l’opposait à la marque HAMILTON, arguant que sa grande notoriété en tant que pilote de Formule 1 conférait à sa demande de marque verbale LEWIS HAMILTON un concept propre et immédiatement perceptible, surplombant les ressemblances existant avec la marque antérieure HAMILTON. Si les éléments de preuve déposés semblent avoir été conséquents (l’examinateur relève que le déposant s’est donné beaucoup de mal pour démontrer que LEWIS HAMILTON est le nom d’un célèbre pilote de Formule 1 reconnu à travers l’Union Européenne6 – et la communication à l’opposant des observations et pièces versées par Lewis Hamilton a en effet dû être effectuée en 14 parties), l’EUIPO se refuse à faire droit aux arguments de Lewis Hamilton, au motif que :
- si la notoriété du pilote dans le domaine du sport automobile est démontrée, il ne peut pour autant en être conclu que cette notoriété s’étend au public pertinent : en l’espèce, nous sommes en classe 14 (principalement joaillerie et horlogerie), et il est souligné qu’à la différence du football, la Formule 1 n’est pas un sport suffisamment populaire pour en déduire qu’il serait évident pour le public pertinent que le signe LEWIS HAMILTON renvoie au pilote automobile (ceci faisant expressément écho à l’analogie effectuée par Lewis Hamilton avec la jurisprudence « Messi » que nous évoquons plus bas) ;
- s’il peut être légitime de déposer son patronyme à titre de marque, cette seule circonstance n’est pas constitutive de droits et ne peut être considérée en tant que telle pour évaluer l’existence (ou en l’occurrence, l’absence) d’un risque de confusion dans le cadre d’une procédure d’opposition ;
- par conséquent, l’élément commun HAMILTON sera perçu au sein de chacun des signes concernés comme une référence à un nom de famille anglo-saxon qui n’est pas très répandu, et l’adjonction du prénom LEWIS n’est pas de nature à exclure cette similarité conceptuelle.
Lewis Hamilton s’est appuyé sur la jurisprudence Messi, opérant une analogie entre la procédure d’opposition le concernant et la décision rendue par la Cour de Justice de l’UE en septembre 2020 dans une autre procédure d’opposition qui avait alors opposé le footballeur Lionel Messi, demandeur de la marque semi-figurative reproduite ci-dessous, au titulaire de la marque verbale antérieure MASSI7 :

Le dépôt de Lionel Messi désignait notamment des produits vestimentaires en classe 25 et des articles de sport en classe 28. Or, la Cour relevait que :
« dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, et en particulier en ce qui concerne la possibilité que les différences conceptuelles entre les signes en cause neutralisent les similitudes visuelles et phonétiques de ces signes, le Tribunal a, au point 75 de l’arrêt attaqué, réitéré la considération selon laquelle la réputation du joueur de football Messi est telle qu’il n’est pas plausible que, en l’absence d’indices concrets contraires, le consommateur moyen, mis en présence du signe MESSI désignant des vêtements, des articles de gymnastique ou de sport ainsi que des appareils et des instruments de protection, fasse abstraction de la signification de ce signe comme faisant référence au nom du célèbre joueur de football et le perçoive principalement comme une marque, parmi d’autres, de tels produits. »8
La décision rendue dans le cadre de l’opposition HAMILTON c/ LEWIS HAMILTON n’est pas en contradiction avec cette décision « Messi », puisque l’examinateur en accepte l’analogie et y répond point par point, pour en tirer la conclusion que les circonstances de l’espèce diffèrent et que les conditions de l’application de la théorie de la neutralisation ne sont pas remplies :
- l’examinateur souligne que la notoriété de Lewis Hamilton, établie dans le domaine du sport automobile, ne s’étend pas ou n’est à tout le moins pas démontrée pour les produits en cause de la classe 14 – alors que celle de Lionel Messi, en sa qualité de footballeur, avait pu être constatée / induite pour les articles vestimentaires de la classe 25 et les articles de sport de la classe 28,
- le signe LEWIS HAMILTON n’a donc pas, dans la perspective du public visé, une signification claire et déterminée qui diffèrerait significativement du signe antérieur HAMILTON – les deux signes, pour leur comparaison conceptuelle, étant dès lors ramenés au patronymique anglo-saxon jugé peu répandu – de sorte que lui fait défaut le poids qu’il aurait ou peser dans la balance opérée entre les similarités visuelle, orale et conceptuelle existantes.
En effet, quelle que soit la notoriété de l’athlète ou plus généralement du déposant / signe postérieur concerné, celle-ci :
- est à elle seule indifférente dans l’appréciation du risque de confusion en tant que tel,
- sauf à être prise en compte dans le seul cadre de la théorie de la neutralisation, à savoir comme point de balance des éventuelles similitudes visuelles et orales, si tant est que cette notoriété soit démontrée dans la perspective du public pertinent et qu’elle confère ainsi au signe concerné une signification claire et déterminée qui diffère de celle du signe avec lequel la comparaison est effectuée
Récemment encore, c’est le club de football de l’AC Milan qui a fait les frais du rappel de ces principes, le Tribunal de l’Union Européenne ayant rejeté son recours à l’encontre de la décision qui avait retenu l’existence d’un risque de confusion entre son dépôt semi-figuratif reproduit ci-dessous et la marque verbale antérieure allemande MILAN9 :

Dans son recours contre les décisions successives de l’EUIPO, le club de football de l’AC Milan soutenait – outre l’argument de la prédominance de son logo dans la comparaison visuelle, qui n’a pas été retenue comme suffisante – que la notoriété de son nom en Allemagne, liée bien sûr au club de foot jouant sous ce nom, n’avait pas été considérée par les examinateurs. Or, le Tribunal souligne, en ligne avec une jurisprudence constante, que :
« s’agissant de l’argument de la requérante tiré de la renommée de la marque demandée en Allemagne, il convient de relever, ainsi que l’a souligné à juste titre l’EUIPO, que seule la renommée de la marque antérieure, et non celle de la marque demandée, doit être prise en compte pour apprécier si la similitude des produits désignés par deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion ».
Pour les raisons déjà détaillées plus haut, cette décision – à la différence de ce que certains commentaires ont pu évoquer – n’est pas plus en contradiction avec la décision rendue dans le cadre de l’affaire « Messi » que notre décision d’opposition concernant Lewis Hamilton. Au contraire, cela est d’autant plus clair que dans la décision ayant impliqué l’AC Milan, la notoriété du club de football semble avoir invoquée à titre général, pour peser dans l’appréciation globale du risque de confusion, alors que si celle-ci avait dû peser sur l’issue de l’examen de l’existence (ou non) d’un risque de confusion, elle aurait dû être invoquée / démontrée / prise en compte au stade de la comparaison conceptuelle, aux fins de pouvoir faire jouer la théorie de la neutralisation. Cela ne semble pas avoir été le cas – et l’opposition s’étant placée sur le terrain de la classe 16, il n’est en outre pas certain que la renommée du club aurait été reconnue du point de vue du public pertinent.
A noter, pour conclure : si la décision d’opposition rendue en décembre 2021 a fait l’objet d’un recours, la première chambre de recours de l’EUIPO a choisi de le rejeter, confirmant la position adoptée par les premiers examinateurs10.
Mise à jour Août 2025
Notes
N.B. : En Formule 1, le « point bonus » était un point supplémentaire attribué à l’issue d’un Grand Prix au pilote ayant réalisé le tour de course le plus rapide. Il s’ajoutait aux points gagnés lors de chaque Grand Prix et sur la base desquels est établi le classement pour l’attribution du titre de Champion du monde. Adopté en 2019, celui-ci a néanmoins été supprimé en 2025.
- Décision d’opposition du 22 décembre 2021, HAMILTON c/ LEWIS HAMILTON, procédure n° B 2 617 200
- Les marques du pilote sont en réalité détenues par l’intermédiaire de sa société, 44IP Limited. Nous emploierons néanmoins le nom de Lewis Hamilton par souci de facilité.
- Décision de la 4ème chambre de recours du 20 octobre 2020, affaire R 351/2020-4
- En effet, dans un arrêt du 14 octobre 2003, le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (qui portait encore ce nom, à l’époque) a été amené à considérer que « les différences conceptuelles séparant les marques en cause sont de nature à neutraliser dans une large mesure les similitudes visuelles et phonétiques » et qu’« il suffit qu’une des marques en cause soit dotée d’une telle signification pour que, lorsque l’autre marque n’a pas une telle signification ou seulement une signification entièrement différente, des similitudes visuelles et phonétiques existant entre ces marques soient neutralisées dans une large mesure » (TPICE, 14 octobre 2003, affaire T-292/01).
- TPICE, 22 juin 2004, affaire T-185/02, confirmé par CJCE, 12 janvier 2006, affaire C-361/04, §55
- L’examinateur relève précisemment que : « The applicant goes to great lengths to prove that LEWIS HAMILTON is the name of a very famous Formula 1 driver who is well-known across the European Union and submits a large number of documents in order to support this claim »
- CJUE, 17 septembre 2020, affaires jointes C‑449/18 P et C‑474/18 P
- Op. cit, §36
- TUE, 10 novembre 2021, affaire T‑353/20
- EUIPO, première chambre de recours, 17 octobre 2023, affaire R 336/2022-1